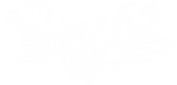L’annonce par François Bayrou à la mi-juillet de 44 milliards d’euros de coupes dans les dépenses publiques et de mesures ouvertement antiouvrières, a été perçue comme une provocation par les classes populaires. À l’origine des journées de grève et de manifestations des 10 et 18 septembre et du 2 octobre, elle a aussi relancé les débats sur la question de la taxation des « ultra-riches ». Après l’impôt sur les grandes fortunes (ISF), dont tous les partis de gauche et plusieurs centrales syndicales réclament depuis des années le rétablissement, ou la taxe Tobin longtemps brandie, c’est désormais la taxe proposée par l’économiste Gabriel Zucman qui fait à leurs yeux office de panacée. Mais c’est un leurre plus que dérisoire dans cette période de pourrissement de l’économie capitaliste.
À la mi-septembre, après la première nomination de Lecornu au poste de Premier ministre, le Parti socialiste avait notamment fait de l’adoption de la taxe Zucman une « ligne rouge », c’est-à-dire une condition à la non-censure du gouvernement. Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, expliquait qu’il ne s’agissait pas d’une lubie pour résoudre les problèmes de déficit budgétaire mais d’une question « fondamentale », presque philosophique, permettant d’arriver à une prétendue égalité devant l’impôt et plus de « justice fiscale ». Plus cyniquement, Sylvain Maillard, ancien chef de file des députés du parti présidentiel, expliquait alors qu’il « fallait offrir à la gauche une victoire symbolique sur l’imposition des plus fortunés ». On sait que sur ce plan, c’est finalement la « suspension » de la réforme des retraites de 2023 qui a servi de monnaie d’échange dans le marché entre Lecornu et les socialistes pour obtenir la non-censure.
Il avait pourtant suffi que cette proposition de taxe, dont le principe avait déjà été voté par l’Assemblée nationale en février 2025, soit de nouveau avancée pour que les porte-parole attitrés ou autorisés de la grande bourgeoisie crient qu’on les égorgeait, qu’il s’agissait d’un impôt confiscatoire et mortel.
Les milliardaires se font entendre et obéir
Bernard Arnault, PDG de LVMH et deuxième fortune française, du haut de ses 120 milliards d’euros, qualifia même à la mi-septembre Gabriel Zucman de « militant d’extrême gauche » cherchant à « mettre à terre l’économie française ». Un procès en sorcellerie un peu délirant quand on sait que cet économiste, certes spécialiste des paradis fiscaux et des inégalités devant l’impôt, a été conseiller des candidats du Parti démocrate américain Elizabeth Warren et Bernie Sanders et qu’il confie « échanger avec les décideurs politiques de tous bords ». Philippe Aghion, récompensé depuis par un prix Nobel d’économie, accusa pour sa part ce même Zucman de vouloir « transformer la France en prison fiscale », quand d’autres évoquaient « une arme idéologique de destruction de l’économie de marché »1. Quant au président du Medef, Patrick Martin, il s’est emporté contre ce qu’il prétend être une « forme de spoliation », et a menacé un temps d’une « mobilisation de grande ampleur » du patronat pour s’y opposer. Cette hystérie était d’autant plus surjouée que Zucman lui-même avoue que ce qu’il préconise, une sorte de contribution plancher de 2 %, visant les plus grandes fortunes, est véritablement le « minimum du minimum » en la matière. C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’elle ne concernerait que les 1 800 foyers disposant de plus de 100 millions d’euros. Son initiateur promettait 20 milliards de rentrées fiscales supplémentaires là où d’autres spécialistes tablaient, avec les mêmes données, sur un chiffre de très loin inférieur.
Mais c’est aussi à ce type de réaction, relayée par toute une galaxie de médias, pour la plupart aux mains du grand patronat, qui montre la détermination de la bourgeoisie à ne rien lâcher dans sa guerre de classe et la conscience qu’elle a de ses propres intérêts. Elle n’a d’ailleurs pas tardé à être obéie par le gouvernement Lecornu 2 qui, pour espérer survivre au débat budgétaire en l’absence de majorité et donner le change à l’opinion publique, a tout juste annoncé une taxe exceptionnelle sur les plus hauts revenus sans même en donner le taux ni le périmètre.
Plus l’économie s’enlise dans la crise, plus les grands capitalistes s’engraissent
La violence des réactions du monde patronal n’a d’égale que la rapacité grâce à laquelle il s’est enrichi depuis plusieurs décennies, sous les gouvernements de droite comme de gauche. D’abord parce que ces mêmes gouvernements ont servi les uns après les autres ses intérêts en s’attaquant aux chômeurs, au droit du travail, aux retraites, aux moyens alloués à la santé ou à l’éducation et surtout en adoptant des mesures toujours plus favorables aux détenteurs de capitaux. Des centaines de dispositifs impossibles à dénombrer – des centaines ? des milliers ? – transfèrent chaque année des fonds publics vers les caisses patronales, pour un montant estimé à 211 milliards d’euros par le Sénat et, plus récemment, à 270 milliards par les auteurs du livre au titre évocateur : Le grand détournement. Comment milliardaires et multinationales captent l’argent de l’État2.
À ces aides multiformes s’est ajoutée notamment la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés, passé du taux de 50 % en 1958 au taux de 33 % en 1993, puis de 25 % en 2022. Encore s’agit-il d’un taux théorique, très éloigné de la réalité. Ainsi, dès 2009, le taux implicite d’imposition des sociétés, c’est-à-dire calculé par rapport aux bénéfices, était évalué à 18 % en moyenne et même à 13 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés, le grand capital bénéficiant des plus importants allègements.3 En 2025, si les groupes cotés au CAC 40 étaient imposés au même niveau que les petits commerçants ou les artisans, ce seraient 10 milliards d’euros supplémentaires qui rentreraient dans les caisses de l’État chaque année4.
L’existence de holdings, des sociétés financières qui détiennent elles-mêmes des parts d’entreprises, permet de classer leurs avoirs dans la catégorie des biens professionnels, qui ne constituent pas un revenu pour l’administration fiscale et ne sont donc pas imposés. Les milliardaires ne paient donc presque plus d’impôts en fonction de leur fortune, moins de 2 % en moyenne, puisque les revenus du capital, dont les dividendes, sont les moins taxés et qu’ils pratiquent, comme la loi les y autorise ou plutôt les y invite, « l’optimisation fiscale » de façon massive avec l’aide de cabinets d’experts dédiés à ces tâches. En 2024, la famille Arnault par exemple s’est versé 3,1 milliards d’euros de dividendes. Ceux-ci, conservés dans des holdings, ne seront pas taxés, la taxation des transferts entre une société mère et ses « filles » étant même interdite dans l’Union européenne. À l’échelle mondiale, celle des grands groupes monopolistiques, l’impôt versé par les milliardaires sur leur patrimoine était estimé en 2023 entre 0 et 0,5 % alors que leur fortune continuait à croître dans des proportions bien supérieures, de l’ordre de 8 à 10 % par an.
En France, le total des 500 plus grandes fortunes, dont 145 milliardaires (contre 16 en 1996), est ainsi passé de 200 milliards à 1 128 milliards d’euros durant les seules quinze dernières années, soit une progression de près de 500 %5. Aujourd’hui, ces 500 parasites pèsent l’équivalent de 42 % du produit intérieur brut, contre 6 % il y a trente ans ! Et les mêmes prétendent encore être contraints par la concurrence d’intensifier les cadences, de licencier des travailleurs dont ils tirent pourtant la plus-value à la source de leurs profits ou de fermer des entreprises.
Il y a effectivement de quoi nourrir une véritable haine de classe contre les dynasties bourgeoises qui possèdent ces sommes gigantesques et le pouvoir exorbitant qu’elles leur donnent sur la société tout entière. Mais ce n’est pas à cela que répondent un Gabriel Zucman ni un Thomas Piketty, avec lequel il a collaboré, ni les organisations syndicales et politiques qui se réclament d’eux, ni les nombreux intellectuels qui ont signé des tribunes pour en réclamer l’adoption, dont Olivier Blanchard, ex-chef économiste du FMI et Jean Pisani-Ferry, ancien conseiller économique du candidat Macron en 2017. La bourgeoisie nourrit d’ailleurs elle-même en son sein des collectifs de millionnaires qui s’expriment dans ce sens dans les médias. En réclamant que les gouvernements les taxent davantage, ils nourrissent un vaste écran de fumée que la gauche, en France, a très largement contribué à produire.
« Faire payer les riches ? » : un leurre ancien et des débats stériles
Tout au long du 19e siècle, la bourgeoisie s’est opposée à la création d’un impôt sur ses revenus, rejetant toute mesure, qualifiée, déjà, de confiscatoire et liberticide, avant de s’y résigner, par crainte du prolétariat et par nécessité. Il fallut attendre 1901 pour qu’un premier impôt progressif sur les droits de succession fût voté, puis 1914 et la Première Guerre mondiale pour que le principe d’un impôt sur le revenu soit adopté sans enthousiasme par le Sénat ; son taux marginal était plafonné à 2 %. Il s’agissait de montrer aux classes populaires, dont les membres étaient envoyés à la mort sur les champs de bataille, que l’Union sacrée existait également sur le terrain financier, que l’impôt du sang avait trouvé un équivalent parmi les possédants. Ce n’est d’ailleurs pas la gauche, mais des gouvernements réactionnaires qui allaient porter ce taux à 60 % en 1920 puis 75 % en 1923.
Après avoir soutenu l’arrivée au pouvoir de De Gaulle en 1945 et gouverné avec lui, les ministres de la SFIO et le PCF jouèrent un rôle déterminant pour étouffer la menace d’une vague de contestation voire de révolution et encadrer la « bataille de la production » dans l’après-guerre, c’est-à-dire l’exploitation forcenée de la classe ouvrière. Pour donner le change, l’idée d’un impôt sur la fortune fut portée par les socialistes Blum et Auriol : une façon d’accréditer l’idée que toutes les couches de la population devaient « fournir un effort » pour redresser l’économie et renflouer les caisses de l’État. Mais c’est bien la création de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 1954, l’impôt le plus injuste, frappant davantage le SDF qui dépense tout son revenu que le millionnaire qui en épargne la plus grande partie, qui allait devenir la première source de recettes du Trésor, atteignant 116 milliards d’euros en 2025.
Droite et gauche rivaliseront de rhétorique sur la question d’un impôt sur la fortune au cours des années 1960 et 1970, une période pendant laquelle la croissance économique pouvait faciliter l’adoption d’une telle mesure. En Allemagne, c’est d’ailleurs le gouvernement conservateur d’Adenauer qui fit voter une taxe de ce genre dès 1949. En France, des élus de droite, de l’UDR à l’UDF puis au RPR, s’y dirent favorables, l’un d’eux dénonçant le fait de ne pas taxer les patrimoines déjà constitués comme une « injustice profonde »6. À gauche, ce sont des députés communistes qui proposèrent l’établissement d’un impôt sur la fortune en 1965 avant que le Programme commun de la gauche de 1972 reprenne cette orientation, tout en restant flou sur ses modalités. Le secrétaire général et candidat du PCF à l’élection présidentielle de 1981, Georges Marchais, se voulut plus clair en affirmant : « Au-dessus de 40 000 francs, je prends tout ! ». Pour le Parti socialiste, François Mitterrand, évoquant le « cancer » que constituaient les inégalités en France fit figurer la promesse d’une imposition à 8 % des patrimoines parmi ses 110 propositions. Une fois parvenue au pouvoir, la gauche se garda bien d’aller trop loin dans ce sens. Lors des débats, le communiste Parfait Jans assura que l’impôt sur les plus hauts patrimoines proposé était « loin d’être lourd et confiscatoire », expliquant : « Il faut donc que les possesseurs de grandes fortunes acceptent de jouer le jeu de la solidarité. » C’était en effet tout le sens de cette politique : demander une petite obole à la bourgeoisie, une participation à l’effort commun dont la charge la plus lourde pèserait sur les classes laborieuses. De fait, cet impôt sur les grandes fortunes (IGF), adopté en 1982, se contenta d’un taux très faible et progressif (allant de 0,5 % pour les fortunes entre 3 et 5 millions de francs, à 1 % entre 5 et 10 millions et à 1,5 % au-dessus de 10 millions de francs). Les œuvres d’art et surtout les mal nommés « outils de travail », c’est-à-dire les biens industriels et productifs eux-mêmes, échappaient à cette mesure. Les 2,7 milliards de francs de rendement de cet impôt en 1982 ne représentaient que 0,6 % des recettes fiscales, ce qui n’empêcha pas l’ancien Premier ministre Raymond Barre de prétendre qu’il agissait sur l’économie à la manière d’une « leucémie ».
Dès lors, la gauche et la droite tenaient leur symbole, les uns pour masquer leur bilan de gouvernement en faveur de la grande bourgeoisie et calamiteux pour les travailleurs, les autres pour dénoncer une politique qu’ils prétendaient néfaste pour l’économie et confiscatoire. Devenu Premier ministre en 1986, Chirac supprima donc l’IGF. Le socialiste Rocard lui succéda deux ans plus tard et ressortit cet impôt du placard en le renommant impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et en le plafonnant à 70 % des revenus. Ses recettes étaient censées financer la création du revenu minimum d’insertion (RMI). Mais du fait des multiples exonérations auxquelles cet ISF donnait lieu, il ne couvrit finalement que les deux tiers des 6 milliards d’euros nécessaires et les fortunes bourgeoises n’en furent qu’à peine écornées. Mais alors naquirent la complainte et le mythe du paysan de l’île de Ré, donné en exemple pour démontrer qu’un héritier sans véritables revenus, mais atteignant le seuil de l’imposition sur les grandes fortunes en raison de la flambée des prix de l’immobilier, serait contraint de vendre son patrimoine. C’est au fond cette fable que ressortent aujourd’hui tous ceux qui font mine de s’étrangler à l’évocation de la taxe Zucman.
Après sa défaite à l’élection présidentielle de 1988, Chirac convint que « la droite ne gagnera jamais une élection en proposant de supprimer l’impôt sur la fortune ». Il fit même de la lutte contre la « fracture sociale » un des axes de sa campagne victorieuse de 1995. Au pouvoir avec Juppé, Chirac abaissa d’abord les réductions d’impôt auxquelles donnait droit le plafonnement de l’ISF. Mais en 2003, il réduisit encore son périmètre par la loi Dutreil avant d’instaurer avec Dominique de Villepin un « bouclier fiscal » en 2006 qui plafonnait à 60 % des revenus annuels le montant cumulé de l’ISF, de l’impôt sur le revenu et de la taxe foncière ; plafond abaissé à 50 % par Sarkozy en 2007. Alors que la crise faisait rage, Bercy remboursa des sommes faramineuses aux plus grandes fortunes. À la veille de l’élection présidentielle de 2012, Sarkozy, qui avait gagné dans l’opinion publique le surnom de « président des riches », supprima ce bouclier… tout en rehaussant les seuils d’entrée dans l’ISF, en abaissant ses taux, et en confortant en réalité les plus gros patrimoines.
C’est ainsi que Hollande avant d’être élu président en 2012 put se présenter en « ennemi de la finance » et proposer une taxe à 75 % sur les revenus supérieurs à un million d’euros, taxe qui allait être vidée de toute substance peu après son arrivée au pouvoir, au profit d’une politique dont le grand capital fut le seul bénéficiaire. En 2016, Le Canard enchaîné publia une liste nominative de cinquante personnes parmi les plus fortunées, dont Bernard Arnault, Liliane Bettencourt et Hélène Darty, ayant bénéficié d’une réduction massive de leur impôt de solidarité sur la fortune. « Résultat burlesque d’une législation bricolée et rafistolée depuis des années », onze de ces bourgeois n’avaient pas payé d’ISF l’année précédente. Et au lieu de devoir s’acquitter de 219,6 millions d’euros, ces cinquante contribuables n’en avaient versé que 21,2. Ainsi la gauche avait mis en place une politique encore plus favorable à la grande bourgeoisie que le bouclier fiscal qu’elle avait supprimé ! Alors que tout contribuable voyait désormais sa déclaration de revenus préremplie, l’ISF faisait l’objet d’une « autodéclaration », sans que les millionnaires et les milliardaires encourent le moindre contrôle. Cet impôt ne rapportait alors annuellement que 5,2 milliards d’euros, soit 1,8 % des recettes fiscales nettes de l’État. À comparer aux 1 600 milliards d’euros stockés par les capitalistes français dans leurs holdings selon les estimations à cette même période.
À l’arrivée de Macron en 2017, l’ISF fut remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Une « flat tax » fut instaurée, soumettant les revenus du capital à un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, comprenant 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Ainsi la grande bourgeoisie put continuer plus sereinement encore à prospérer.
Aujourd’hui, dans un contexte de guerre économique, commerciale et de marche à la guerre, les gouvernements sont sommés par cette même bourgeoisie d’imposer des mesures d’austérité drastiques. L’État doit continuer à rembourser ses créanciers, c’est-à-dire les banques et tous ceux qui vivent des intérêts qu’il doit verser sans diminuer le débit de la « pompe à phynance » qui alimente des caisses patronales bien plus remplies encore que celles du Père Ubu. Cela nécessite de nouvelles attaques contre les chômeurs, les travailleurs en exercice ou retraités, les malades, les personnes âgées, alors qu’il n’existe pas de gouvernement stable et de partis disposant du crédit nécessaire pour les imposer sans risquer l’explosion sociale.
Le gouvernement doit aujourd’hui tenter de donner le change. Gabriel Zucman expliquait récemment : « Il va être très difficile de demander aux Français de faire des efforts tant que les milliardaires paieront si peu d’impôts »7 Ce serait donc le faible prix qu’ils devraient payer pour continuer à s’engraisser sans heurts. Même le très réactionnaire et éphémère gouvernement Barnier avait ainsi proposé à l’automne 2024, de façon « exceptionnelle et temporaire », une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)… qui vient d’être reconduite par Lecornu. Le ou les quelques milliards d’euros qu’elle est supposée rapporter sont mis en avant pour tenter de faire oublier la trentaine de milliards de coupes budgétaires déjà programmée et les centaines de milliards de cadeaux à verser au grand patronat.
Exproprier la bourgeoisie, en finir avec l’exploitation
Les partis de gauche s’accrochent aujourd’hui à la vessie de la taxe Zucman qu’ils transforment en lanterne magique. Un de leurs mentors, Thomas Piketty, traduisant une expression allemande de l’après-Deuxième Guerre mondiale, évoque à ce propos le nécessaire « partage du fardeau » entre les classes.
Dans le même esprit, la CFDT, non désavouée par l’intersyndicale regroupant toutes les confédérations, répète à l’envi que le pays a besoin d’un budget et que les « efforts doivent être partagés par tous, pas seulement les travailleurs, travailleuses, les personnes les plus précaires, etc. ». Au lendemain des manifestations du 10 et 18 septembre, sa secrétaire, Marylise Léon, affirmait que les travailleurs « refusent d’être les seuls à faire des sacrifices », ce qui signifiait qu’ils devaient accepter pleinement d’en faire de nouveaux.
Ayant renoncé de longue date à toute politique s’en prenant vraiment au capital, c’est-à-dire à sa direction de l’économie et de l’État, la gauche ressasse les vieilles fariboles sur le « consentement à l’impôt ». « Que chacun contribue à la chose publique selon ses moyens », avançait ainsi un député communiste il y a quelques années en proposant le rétablissement de l’ISF. Un rétablissement que prônaient d’ailleurs conjointement, bien qu’à des niveaux différents, les partis du Nouveau front populaire (NFP) et le Rassemblement national aux législatives de 2024.
Mais les travailleurs ne peuvent mettre leurs espoirs dans une énième mouture de cette forme d’imposition. Ceux qui pointent du doigt les « ultra-riches » ou, plus vaguement encore, « l’oligarchie », emploient d’ailleurs ces termes pour ne pas désigner les capitalistes, la bourgeoisie et son ordre social qui repose sur l’exploitation, la propriété des grands moyens de production, de communication, du commerce comme des banques.
C’est aujourd’hui plus que jamais la perspective de la réquisition des profits, des dividendes distribués, et l’expropriation de la bourgeoisie dont les révolutionnaires doivent propager l’idée. Il ne faut pas seulement condamner les inégalités et les injustices, mais préparer le renversement d’un système d’exploitation aux mains d’une bourgeoisie de plus en plus parasitaire.
C’est la base du combat des communistes révolutionnaires. Analysant en 1865 les rapports entre les salaires, les prix et les profits, Marx, tout en soutenant l’objectif des augmentations de salaire, engageait les ouvriers à ne pas « s’exagérer le résultat final de cette lutte quotidienne ». Il expliquait qu’ils ne pouvaient que retenir « le mouvement descendant » de leur condition, mais non « en changer la direction », qu’ils n’appliqueraient « que des palliatifs, mais sans guérir le mal ». Et au lieu du mot d’ordre ancien : « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », il les invitait à inscrire sur leur drapeau le mot d’ordre révolutionnaire : « Abolition du salariat ». Alors que l’économie capitaliste démontre son impuissance à résoudre les problèmes fondamentaux de l’humanité et mène celle-ci vers une guerre mondiale, la classe ouvrière doit combattre non pas pour « faire payer les ultra-riches » ou « répartir les richesses », mais pour renverser le capitalisme et exproprier la bourgeoisie.
15 octobre 2025
1Les Échos, 18 septembre et 3 octobre 2025.
2Mathieu Aron, Caroline Michel-Aguirre, Allary éditions, 2025.
3Rapports du Conseil des prélèvements obligatoires : Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie mondialisée, octobre 2009, et Entreprises et « niches » fiscales et sociales – Des dispositifs dérogatoires nombreux, octobre 2010.
4L’Humanité, 14 octobre 2025.
5Chiffres du magazine Challenges, juillet 2025.
6Jacques Chaumont, lors des débats sur cette question en 1976.
7Le Monde, 11 septembre 2025.