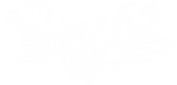1re édition (1908). Syllepse, 2024.
L’origine du christianisme a été publié en 1908 par l’un des principaux dirigeants de la social-démocratie allemande, Karl Kautsky. Le choix de ce sujet peut paraître éloigné de la vie et des luttes du prolétariat. Mais comme l’explique l’auteur dans un avant-propos, étudier ce phénomène historique avec la méthode matérialiste permet de répondre à l’idée que les premiers chrétiens étaient des communistes et aux parallèles qui étaient souvent faits, à son époque, entre la lutte des premiers disciples de Jésus et celle des prolétaires modernes. Il est vrai qu’Engels, dans son introduction à la réédition des Luttes de classes en France de Marx en 1895, avait fait une comparaison entre les progrès de la social-démocratie et le succès fulgurant du christianisme à la fin de l’Antiquité. Mais le livre de Kautsky montre qu’il s’agissait, de sa part, d’un « rapprochement plein d’humour » permettant de « souligner l’avancée imparable et rapide » du mouvement socialiste prolétarien, tout en sachant que les aspirations égalitaires et anticonformistes des premiers chrétiens n’avaient rien à voir avec le communisme du prolétariat moderne.
Kautsky s’adresse aux militants de la social-démocratie et non aux spécialistes du christianisme ; le livre est accessible à tous ceux qui veulent découvrir cette période ancienne sous la plume d’un marxiste. Pour comprendre les débuts du christianisme, il faut étudier la société qui a produit cette nouvelle religion. Kautsky consacre donc la moitié de son livre à la société romaine entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, et en décrit les rapports de classe. La société romaine était fondée sur l’esclavage et dominée par de grands propriétaires terriens, l’essentiel de l’activité productive y étant l’agriculture. Il existait également une activité commerciale et financière dans les villes et un prolétariat urbain vivant pour partie de l’artisanat, et pour partie de distributions de nourriture financées par l’État. Mais celui-ci était extrêmement minoritaire dans une période où, globalement, les forces productives stagnaient et où la richesse de l’État venait avant tout du pillage des provinces.
Cette analyse des forces productives et des classes sociales permet de comprendre les idées qui circulaient alors. Le développement du christianisme est un produit de l’évolution de la société romaine et de ses contradictions. D’un côté, l’unification économique et politique du bassin méditerranéen sous la domination de Rome favorisait l’idée d’un dieu universel, à l’opposé des religions antiques traditionnelles où chaque communauté avait ses propres dieux. Le despotisme de l’empereur, honoré comme un dieu, allait dans le même sens en suggérant qu’une divinité unique régnait sur le monde. D’un autre côté, toute contestation de l’ordre social s’exprimait logiquement sur le plan religieux. La violence de l’occupation romaine en Judée entraînait des schismes parmi les Juifs, entre ceux qui appelaient à résister par les armes et ceux qui se soumettaient ou qui se retiraient dans le désert. L’époque de Jésus vit donc, dans cette région, l’apparition de nombreuses sectes ; mais la particularité des fondateurs du christianisme fut de s’adresser à tous les habitants de l’Empire, et non aux seuls Juifs. Et partout, les souffrances des esclaves et du petit peuple des villes firent le succès des prédicateurs qui proposaient de rejoindre une communauté chrétienne au fonctionnement égalitaire.
Le communisme des premiers chrétiens n’a pas été le point d’appui de luttes contre les injustices de la société de leur temps. Au contraire même, en promettant l’égalité entre tous dans le royaume de dieu, les fondateurs du christianisme prêchaient en fait la patience face aux injustices du monde réel. De riches aristocrates romains pouvaient devenir chrétiens et pratiquer la charité sans remettre en cause la domination de leur classe. Et lorsqu’au début du 4e siècle l’empereur Constantin se vanta d’être protégé par le Christ et de lui devoir ses succès militaires, puis se convertit au christianisme, l’Église chrétienne devint une Église officielle. Elle défendit l’ordre social, la domination des grands propriétaires terriens et la soumission des pauvres et des esclaves : « Le christianisme n’a triomphé qu’après être devenu l’exact contraire de ce qu’il était à l’origine ; dans le christianisme, ce n’est pas le prolétariat qui a remporté la victoire, mais le clergé qui l’a exploité et dominé ; le christianisme n’a pas vaincu comme force subversive, mais comme force conservatrice », écrit Kautsky (p. 475).
Théoricien reconnu du marxisme à l’époque, Kautsky allait, après 1914, en oublier le caractère révolutionnaire au point que Lénine le qualifie de « renégat ». Mais dans L’origine du christianisme, il montre la différence fondamentale entre le communisme des premiers groupes de chrétiens et celui des prolétaires modernes, en concluant : « Le communisme chrétien primitif était un communisme de la répartition des richesses et de l’uniformisation de la consommation, le communisme moderne est un communisme de la concentration des richesses et de la production. » Pour le prolétariat, le communisme n’est pas une utopie permettant à des groupes d’opprimés de s’entraider en espérant un monde meilleur, mais un programme de lutte pouvant, comme le dit la dernière phrase du livre, « mettre fin pour toujours à la domination de classe ». Faire l’histoire de la société romaine et de l’émergence d’une nouvelle religion est pour le Kautsky de l’époque l’occasion de défendre les perspectives socialistes et révolutionnaires du prolétariat moderne.
16 octobre 2025