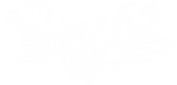Après la signature lundi 13 octobre, à Charm el-Cheikh en Égypte, d’un accord entre le gouvernement israélien et le Hamas, sous le patronage américain, un cessez-le-feu est entré en vigueur.
Trump a présenté l’accord comme le début d’une « paix éternelle » au Moyen-Orient, « pour la première fois depuis 3 000 ans ». Mais à l’étape actuelle, il ne s’agit que d’une trêve dont rien ne garantit qu’elle soit moins fragile que les deux précédentes. La première, fin novembre 2023, avait duré une semaine et avait permis l’échange de 81 otages israéliens contre 240 prisonniers palestiniens. La deuxième, du 19 janvier au 2 mars 2025, avait permis la libération de 30 otages israéliens et devait constituer la première phase d’un processus de négociation. Mais le gouvernement israélien y avait mis fin brutalement, reprenant les bombardements, relançant une offensive terrestre de grande ampleur et procédant pendant plusieurs semaines à un blocus total de l’enclave de Gaza afin de réduire sa population à la famine.
Loin de garantir une paix éternelle, rien ne dit que la trêve actuelle ne débouche pas, comme les deux précédentes, sur une reprise de la guerre.
Vers la mise en place d’un protectorat américain ?
Pour obtenir cet accord, Trump a tordu le bras à Netanyahou, le contraignant à accepter à la Maison Blanche, devant les caméras des télévisions du monde entier, ce qu’il avait refusé la veille à la tribune de l’ONU. Pour s’assurer qu’aucun revirement n’aurait lieu, Trump a envoyé son secrétaire d’État et son gendre participer à la réunion du gouvernement israélien convoquée pour discuter de la signature du texte négocié en Égypte. Preuve, s’il en était besoin, que Netanyahou a eu besoin de l’aval de son protecteur américain pour se livrer au massacre des habitants de Gaza pendant deux ans.
Sur le fond, le plan de Trump est dans la continuité de ceux qui ont été négociés depuis deux ans. Ainsi Antony Blinken, l’ancien chef de la diplomatie américaine sous Joe Biden, a déclaré, le 2 octobre : « Il s’agit essentiellement du plan que nous avons élaboré au cours de nombreux mois et que nous avons plus ou moins laissé dans un tiroir pour la nouvelle administration. »
Le plan actuel prévoit que le territoire de Gaza serait administré par un comité palestinien apolitique, qui reste à préciser et à mettre en place, chapeauté par un conseil de la paix présidé par Trump lui-même et au sein duquel pourrait figurer l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Des États arabes, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, seraient invités à s’impliquer dans l’administration de Gaza et, en particulier, dans le financement de sa reconstruction.
Le contrôle de l’enclave palestinienne serait assuré par une force internationale, sans qu’on sache qui la constituerait et sans qu’aucun calendrier ait été défini. L’envoi de 200 soldats américains dans la région a été annoncé, mais Trump a assuré qu’aucun d’entre eux ne mettrait les pieds à Gaza. En attendant le déploiement de cette force encore dans les limbes, l’armée israélienne continuerait d’occuper plus de la moitié de l’enclave palestinienne. Ce plan revient en fait à y établir un protectorat dirigé par les États-Unis, coadministré par Israël et les États arabes, et dans lequel les Palestiniens n’auraient pas leur mot à dire.
Un conflit créé par les grandes puissances coloniales
Tout se passe comme si les dirigeants du monde impérialiste ne trouvaient pas d’autre solution que de revenir, sous une forme à peine différente, à la politique coloniale menée à l’issue de la Première Guerre mondiale, quand le Royaume-Uni et la France s’étaient partagé le contrôle des États issus du dépeçage de l’Empire ottoman. Mais pour donner une apparence présentable à leur politique de brigandage, ils s’étaient fait attribuer des mandats sur ces nouveaux États par la Société des nations, l’ancêtre de l’ONU, assortis de la mission de les conduire à l’indépendance quand les conditions seraient réunies. D’ici là, ces mandats leur donnaient le droit d’y établir leur administration et d’y déployer des troupes. Pour asseoir leur domination, les puissances mandataires ont attisé les affrontements entre les populations, quand ils ne les créaient pas. En Palestine, dans le prolongement de la politique engagée pendant la guerre mondiale, les autorités britanniques ont favorisé le renforcement des organisations sionistes, qui revendiquaient la création d’un État juif. Mettant en avant le mot d’ordre : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », le mouvement sioniste se présentait ouvertement comme porteur d’un projet colonial se fixant l’objectif d’évincer les populations locales et il ne pouvait que susciter leur opposition. C’était bien le calcul de l’administration britannique qui pouvait se poser en arbitre d’un conflit qu’elle avait contribué à faire naître et justifier ainsi le maintien de sa tutelle sur les populations juives et arabes.
Affaibli par la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni a dû se résoudre à évacuer son administration et ses troupes. Mais sa politique du « diviser pour mieux régner » a donné naissance, dans cette région du monde comme dans bien d’autres parties de son empire colonial, à un conflit qui continue de produire ses effets dévastateurs.
L’État israélien, gendarme de l’ordre impérialiste
Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, nouvelle puissance dominante dans la région, ont poursuivi à leur tour la politique consistant à alimenter les divisions entre les peuples. Ils ont notamment choisi d’appuyer l’État d’Israël contre les États arabes, dont certains dirigeants cherchaient à s’affranchir de la tutelle des grandes puissances occidentales, se tournèrent alors vers l’Union soviétique. Cette politique permettait aussi à ces dirigeants arabes de trouver un soutien dans une population au sein de laquelle, dans cette période, les idées anti-impérialistes rencontraient un fort écho. Arrivé à la tête de l’Égypte en 1952 à la suite d’un coup d’État, Nasser devint pendant plusieurs années la principale figure de ce nationalisme arabe qui prétendait mettre fin à la domination héritée de l’époque coloniale. En attaquant l’Égypte en juin 1967, lors de la guerre des Six-Jours, Israël se faisait le bras armé de l’impérialisme. Le conflit israélo-arabe servait donc les intérêts des États-Unis, qui n’avaient ainsi aucune raison de chercher à y mettre fin. Avec Israël, ils disposaient d’un allié d’autant plus fiable que celui-ci avait, face à ses voisins, un besoin vital de la protection américaine, de son aide militaire et financière.
Mais, pour faire prévaloir leurs intérêts, les États-Unis ont aussi besoin de s’appuyer sur d’autres États, capables de jouer eux aussi le rôle de gendarmes de la région. Cela a été le cas pendant longtemps de l’Iran du chah. Les monarchies pétrolières, en particulier l’Arabie saoudite, comptent depuis leur naissance parmi leurs alliés fidèles. Après la mort de Nasser en 1970, son successeur, Anouar el-Sadate, a ramené l’Égypte dans l’orbite des États-Unis. Aujourd’hui, ce pays est le deuxième bénéficiaire de l’aide américaine, après Israël. Pour disposer d’alliés dans le monde arabe, les États-Unis doivent préserver une image d’arbitre cherchant à trouver une solution au conflit israélo-palestinien, capable de tancer un peu les gouvernements israéliens quand ils vont trop loin, mais sans jamais aller jusqu’à les contraindre à modifier fondamentalement leur politique vis-à-vis des Palestiniens.
La solution à deux États
Depuis cinquante ans, chaque locataire de la Maison Blanche a prétendu avoir son plan de paix pour le Moyen-Orient et s’est déclaré à un moment ou un autre en faveur d’une « solution à deux États », promettant ainsi la création d’un État palestinien, prévu d’ailleurs dans le plan de l’ONU de 1947. Les accords d’Oslo, en 1993, signés entre le Premier ministre israélien, Rabin, et le dirigeant de l’OLP, Arafat, à Washington, en présence du président américain Clinton, ont été le plus loin dans ce sens. Une administration palestinienne, l’Autorité palestinienne, a été mise en place avec le droit de gérer le territoire de Gaza et une partie de la Cisjordanie. Mais à aucun moment les dirigeants israéliens n’ont véritablement envisagé d’aller jusqu’à reconnaître un État palestinien à part entière. L’Autorité palestinienne devait, à leurs yeux, se cantonner à jouer le rôle d’auxiliaire de police capable de faire accepter à sa population la perpétuation de l’occupation israélienne.
À aucun moment les États-Unis n’ont envisagé de contraindre l’État israélien à reconnaître un État palestinien, à aucun moment ils n’ont fait quoi que ce soit pour empêcher le développement de la colonisation en Cisjordanie, qui constitue une annexion rampante de ce territoire.
À sa façon plus fantasque que celle de ses prédécesseurs, Trump a finalement adopté la même attitude. Après avoir repris à son compte le programme de l’extrême droite israélienne en proposant la création d’une Riviera à Gaza et la déportation de ses habitants, il se déclare aujourd’hui opposé à l’annexion des territoires palestiniens, et a même évoqué à son tour la création d’un État palestinien, envisagée certes très timidement et comme une perspective très lointaine.
Quel avenir pour Gaza ?
À court terme, si la guerre ne reprend pas, il est donc prévu qu’une nouvelle administration palestinienne se mette en place, excluant officiellement le Hamas. L’intégration de représentants de l’Autorité palestinienne lui apporterait une caution politique. La présence de son président, Mahmoud Abbas, lors de la signature de l’accord en Égypte, montre que celui-ci est disposé à prêter son concours à cette opération. Les États arabes, appelés à superviser et à financer cette administration, se verraient ainsi remis en selle face à un État israélien incité par son protecteur américain à modérer ses ambitions régionales.
Trump pourrait ainsi tenter de relancer le « processus de normalisation » inauguré par les accords d’Abraham, signés lors de son premier mandat, en septembre 2020, entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Par ce processus, ces États s’engageaient ouvertement dans la voie d’une coopération, notamment économique, avec Israël, reléguant ainsi officiellement la question palestinienne à l’arrière-plan. Dans les mois qui avaient suivi, le Soudan et le Maroc avaient à leur tour « normalisé » leurs relations avec Israël et l’Arabie saoudite s’apprêtait à le faire quand survint le 7 octobre. Ce rapprochement a été interrompu par la guerre à Gaza.
Les dirigeants des États arabes peuvent donc trouver un intérêt à l’application du plan Trump. En étant intégrée à la nouvelle administration de Gaza, une minorité de Palestiniens peut y gagner le droit d’accéder à des privilèges, certes réduits, à la mesure de ce que peuvent espérer les couches dirigeantes des pays pauvres.
Le Hamas lui-même peut trouver une place dans cette future administration. Dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 13 octobre, les miliciens du Hamas sont ressortis de leurs souterrains – on estime qu’il a pu déployer 7 000 hommes armés – et ont entrepris de reprendre le contrôle de Gaza, exécutant des Palestiniens, désignés comme des membres de gangs ayant collaboré avec Israël. Mais le Hamas a aussi tenu à démontrer à l’ensemble des habitants et aux éventuels opposants qu’il restait le maître de Gaza. Trump a apporté son soutien à cette reprise en main brutale : « Ils veulent résoudre les problèmes, a-t-il répondu à un journaliste, ils l’ont dit ouvertement et ils ont notre accord pour une période. » Par la suite, le président américain a modéré son propos, déclarant que le Hamas devait cesser de tuer des gens. Sous-traiter l’encadrement de la population gazaouie au Hamas, Israël et les États-Unis l’ont fait entre 2007 et 2023. Ils pourraient donc continuer à le faire, à la condition que cela n’apparaisse pas trop ouvertement. De son côté, l’organisation islamiste y est tout aussi disposée.
Le Hamas n’a pas été éradiqué, contrairement à ce que proclame Netanyahou, et il pourra peut-être conserver son rôle de gardien de prison des Palestiniens de Gaza que lui ont reconnu les dirigeants israéliens entre 2007 et 2023. Mais la population palestinienne a payé cette politique par deux années d’une guerre dévastatrice dont les conséquences continueront de se faire sentir dans les années à venir, même si la guerre ne reprend pas.
Depuis octobre 2023, le territoire de Gaza a été totalement ravagé. Plus de 67 000 Palestiniens ont trouvé la mort, des centaines de milliers ont été blessés. Plus de 90 % des logements ont été endommagés ou totalement détruits. Les hôpitaux, écoles, universités et toutes les infrastructures les plus indispensables – les centrales thermiques, les stations d’épuration d’eau – ont été détruits, systématiquement ciblés par les bombardements. Bien que la bande de Gaza ait été fortement dépendante des importations avant le début de la guerre, une grande partie de sa subsistance provenait de l’agriculture et de la production alimentaire à l’intérieur du territoire. Dans le nord et le centre de Gaza, où se pratiquait l’essentiel de l’agriculture, de vastes étendues de terre sont dévastées.
La population israélienne sous la menace de l’extrême droite
La population israélienne, elle aussi, a payé chèrement ces deux années de guerre, la plus longue qu’ait connue ce pays. Toute la vie sociale a été bouleversée par la mobilisation des réservistes, qui ont parfois été rappelés plusieurs fois dans l’année. Plusieurs centaines d’Israéliens ont trouvé la mort : en janvier, l’armée de Terre a estimé avoir eu 900 tués et 6 000 blessés. Beaucoup de ceux qui ont été envoyés à Gaza en sont revenus traumatisés par ce qu’ils avaient vu, et parfois aussi par ce qu’ils avaient fait, car la barbarie d’une guerre marque d’une façon ou d’une autre tous ceux qui y prennent part.
La grande majorité de ceux qui ont manifesté ces derniers mois pour l’arrêt de la guerre désignaient Netanyahou comme responsable de la politique de surenchère guerrière menée depuis deux ans. S’il l’est éminemment, Netanyahou subissait lui-même la pression de l’extrême droite qui imposait ses exigences. Aux élections de novembre 2022, les partis ultranationalistes ont obtenu 10 % des voix. Netanyahou a besoin de leurs députés pour disposer d’une majorité à la Knesset et se maintenir au pouvoir. Plusieurs d’entre eux siègent dans son gouvernement, occupant notamment le ministère des Finances et celui de la Sécurité publique, ce qui leur permet de renforcer leur audience, leur influence dans la police et d’accélérer fortement la colonisation.
Cette extrême droite a été nourrie par la politique des gouvernements israéliens depuis 1948 qui a créé un état de guerre permanent contre les États arabes et les Palestiniens. Une telle politique ne pouvait que renforcer le racisme et les courants ultranationalistes au sein de la population israélienne. Mais c’est surtout la politique de colonisation menée dans les territoires occupés après la guerre de 1967, dans la partie orientale de Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, qui a joué un rôle décisif dans cette évolution. Tous les gouvernements israéliens l’ont tolérée, y compris celui de Rabin, quand ils ne l’ont pas encouragée ouvertement. Ces colonies, où vivent aujourd’hui plus de 600 000 personnes, ont donné une base militante et nombreuse aux mouvements partisans de l’annexion des territoires occupés et de l’expulsion des Palestiniens. Les colons s’attaquent aux Palestiniens pour leur voler leurs terres en Cisjordanie, mais ils manifestent aussi en Israël même, où ils se livrent à des expéditions contre les Arabes qui y vivent, cherchant à rendre impossible toute cohabitation. L’extrême droite a acquis un poids croissant dans l’armée israélienne. D’après un journaliste de Haaretz, près de 30 % des conscrits recrutés dans les unités de combat appartiennent au sionisme religieux, 13 % des commandants de compagnies sont des colons religieux.
Cette extrême droite menace de plus en plus de s’en prendre à tous ceux qui s’opposent à elle, désignés comme des ennemis de l’intérieur, et d’imposer un régime de plus en plus autoritaire, ouvertement ségrégationniste à l’égard des Palestiniens, y compris les Arabes israéliens, qui représentent 20 % de la population israélienne. Une telle évolution est le produit de la politique d’oppression menée contre les Palestiniens – tant il est vrai qu’un peuple qui en opprime un autre ne peut être libre – et elle ne peut que conduire à de nouvelles guerres toujours plus longues et meurtrières.
Pour une fédération socialiste des peuples du Moyen-Orient
Le plan Trump n’apportera aucune paix durable car il ne représente qu’un nouvel épisode dans la longue série des interventions des grandes puissances qui ont créé et alimenté le conflit israélo-arabe. Aucune solution ne pourra être trouvée dans le cadre du système impérialiste qui, partout dans le monde, dresse les peuples les uns contre les autres pour pouvoir tous les dominer. La seule issue pour les populations de la région, israélienne et arabe, ne pourra venir que d’une lutte commune pour abattre les différents régimes qui les oppriment. La classe ouvrière est la seule à n’avoir aucun intérêt au maintien des frontières actuelles car elle n’a aucun privilège, ni social ni national, à défendre.
En luttant pour en finir avec l’exploitation et toutes les formes d’oppression, elle est la seule à pouvoir offrir un autre avenir. Elle est la seule à pouvoir bâtir une organisation économique dont l’objectif serait de satisfaire les besoins du plus grand nombre et de mettre fin à la pauvreté et au sous-développement dans lequel le capitalisme maintient les populations de la grande majorité du monde. Les peuples de la région ne pourront coexister pacifiquement que dans le cadre d’une fédération, reconnaissant à tous des droits égaux, sans oppression, sans exploitation, c’est-à-dire une fédération socialiste des peuples du Moyen-Orient.
Pour qu’une telle perspective puisse devenir un objectif de combat pour des millions d’exploités, il faudra qu’existent des partis et une Internationale se réclamant du communisme révolutionnaire. Contribuer à les construire est bien la tâche prioritaire aujourd’hui.
20 octobre 2025