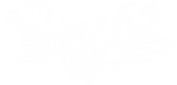En août 1925, les armateurs britanniques, en accord avec les dirigeants du syndicat national des marins et soutiers NSFU (National Seamen and Firemen’s Union), annoncèrent une réduction des salaires d’une livre sterling par mois, soit 10 % [Les marins sont sur le pont, les soutiers (aussi appelés chauffeurs) à la machine.]. Le secteur en avait besoin, disaient-ils conjointement, pour se remettre sur pied. Apprenant la nouvelle en touchant au port, les marins de commerce réagirent les uns après les autres. Si bien qu’au début du mois de septembre, des dizaines de cargos et paquebots étaient bloqués en rade, dans tout l’Empire britannique, à Londres, Glasgow et Southampton comme en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Deux mois durant, des dizaines de milliers de marins allaient affronter sur quatre continents les armateurs les plus riches du monde et, derrière eux, l’État britannique, ses lois, ses juges et sa police. La presse se déchaîna contre le « complot rouge » et l’appareil syndical condamna la lutte des marins.
Un Empire en déclin
La marine britannique n’était plus, en 1925, ce qu’elle avait été jusqu’en 1914, la première du monde avec 40 % du nombre total de navires à vapeur, 60 % des capacités mondiales de construction navale et, de très loin, la première flotte de guerre. La Grande-Bretagne ne régnait plus sur les mers, de plus en plus concurrencée, voire remplacée par les États-Unis. Mais l’antériorité de la bourgeoisie britannique, son Empire, son expérience et l’importance de la City, la place financière de Londres, lui assuraient encore de confortables revenus. Lord Inchcape, par exemple, modèle de l’armateur tout-puissant, principal actionnaire et dirigeant de la compagnie P & O (la première au monde dans les années 1920 avec 500 navires), de l’Anglo-Persian Oil (future BP), de la Compagnie du canal de Suez et de quelques autres, était considéré comme l’homme le plus riche du pays et l’un des plus riches du monde. La structure même de l’économie britannique, depuis longtemps tournée vers le large, reposant en grande partie sur l’exploitation de ses colonies et les échanges avec ses dominions, nécessitait un réseau dense de transports maritimes ininterrompus1. Il fallait une flotte nombreuse pour transporter les marchandises de toutes sortes, le courrier, les fonctionnaires de l’Empire, civils et militaires, les troupes, les employés des compagnies internationales et, évidemment, les nombreux émigrants quittant la mère patrie pour l’Australie, l’Afrique du Sud ou l’Amérique.
Confrontée à l’Allemagne et aux États-Unis, deux pays où le capital industriel était plus concentré, moderne et performant, la Grande-Bretagne perdait du terrain depuis la fin du 19e siècle. La Première Guerre mondiale enfonça un peu plus le pays dans l’obsolescence économique, mettant définitivement les États-Unis au premier rang. Au début des années 1920, le patronat britannique, contraint comme tous les autres à faire des concessions aux travailleurs dans les années de tourmente révolutionnaire ouverte par la révolution russe d’octobre 1917, voulait reprendre, et plus encore, ce qu’il avait dû lâcher. La pression sur les salaires et les conditions de travail s’accentua. En juin 1925, le patronat des mines avertit qu’il allait réduire les salaires de 10 %. Les organisations syndicales de mineurs, rejointes par toutes les autres fédérations, sauf celle des marins, menacèrent alors d’avoir recours à la grève générale et en fixèrent la date. Avant le jour dit, le « vendredi rouge » du 31 juillet 1925, le gouvernement du Premier ministre conservateur Baldwin assura qu’il se chargeait de compléter le salaire des mineurs afin qu’ils ne subissent aucune diminution de revenu. La grève fut donc décommandée et la tactique syndicale qualifiée de triomphe par les dirigeants qui l’avaient promue.
En fait, patronat, gouvernement et leaders syndicaux s’étaient entendus pour mettre en scène cette petite comédie. Le patronat et le Premier ministre estimaient qu’il était trop tôt pour une épreuve de force, les caisses antigrèves et les troupes de briseurs de grève n’étant pas encore prêtes. Les chefs syndicaux furent heureux de s’en tirer à si bon compte et retournèrent à leur routine sans évidemment préparer les travailleurs à l’attaque suivante, qui ne manqua pas d’arriver, en 19262.
Le syndicat des marins : des grèves puissantes à la collaboration de classe
Le syndicat des marins et soutiers avait, lui, accepté une telle réduction des salaires pour ses membres. Son dirigeant, Joseph Havelock Wilson (1858-1929), pensait manifestement avoir l’autorité pour faire avaler la pilule aux équipages ou être capable d’organiser, conjointement avec le patronat, des équipes de briseurs de grève.
Son organisation, la NSFU, était l’héritière des syndicats de masse nés après les grèves des gaziers, des dockers et des marins de Londres en 1889. Ce mouvement avait entraîné la couche du prolétariat la plus misérable, celle des ouvriers qui, jusque-là, se battaient entre eux chaque matin pour arracher une journée de travail. « Voilà un renouveau que je suis fier d’avoir connu », avait alors déclaré le vieux révolutionnaire et londonien de longue date Friedrich Engels. Ces « nouveaux syndicats » s’étaient ensuite renforcés à l’occasion de la « grande révolte ouvrière » des années 1910-1914, qui vit les effectifs totaux des syndicats passer de 2,5 à 4 millions. Toutefois leur objectif restait l’amélioration des conditions de vie et de travail dans le cadre du système existant et, si possible, en bonne entente avec le patronat. La richesse de la bourgeoisie britannique et les profits colossaux qu’elle tirait de l’exploitation coloniale laissaient, en effet, du « grain à moudre » (l’expression est d’époque) pour la couche supérieure de la classe ouvrière et ses représentants officiels.
Le syndicat des marins est représentatif de cette période. Son chef inamovible, Joseph Havelock Wilson, quoique venant du prolétariat et prétendant défendre les intérêts des travailleurs de la mer, fut député, au compte du parti libéral, un des deux partis de la bourgeoisie britannique, dès 1892 – il n’avait affiché la couleur de « travailliste indépendant » que le temps de la campagne ! Le syndicat eut pourtant à se battre contre des armateurs qui avaient à leur disposition, en permanence, des centaines de jaunes, prêts à aller faire le coup de poing d’abord et à embarquer ensuite pour remplacer un équipage gréviste dans n’importe quel port d’Europe. Cette organisation était ouvertement financée et organisée par l’association des armateurs, au titre de la défense de la liberté du travail. La NSFU mena la bataille, dans de nombreux conflits partiels, souvent violents, y compris en organisant une « grève internationale des marins » en juin 1911, qui toucha Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, et quelques ports de la côte est des États-Unis. Elle fut reconnue comme représentative par la plupart des armateurs et par l’administration, et voulut imposer pour ses membres l’exclusivité du travail sur les navires britanniques.
Cette revendication, le contrôle des travailleurs sur l’embauche par l’intermédiaire de leur syndicat, fut celle des dockers de tous les grands ports du monde. Imposée dans des luttes épiques, elle visait légitimement à se présenter unis contre l’employeur plutôt que mis en concurrence entre travailleurs pour savoir qui aurait le droit de décharger le cargo arrivé dans la nuit. Étendue à l’ensemble des travailleurs, elle était à cette époque, écrit Trotsky dans Où va l’Angleterre ? (1925), la manifestation de la conscience de classe des travailleurs et la préfiguration de la dictature du prolétariat. Mais, appliquée par Havelock Wilson aux marins, sur la base nationale et non sur une base de classe, pour défendre des privilèges bureaucratiques et non pour préparer les travailleurs au pouvoir, elle contribua au contraire à les désarmer.
Il est fréquent qu’un capitaine ait besoin de marins supplémentaires et qu’il les recrute, là où il est, à l’autre bout du monde. Les compagnies ne s’en privaient pas, au contraire, ne serait-ce que pour économiser sur les salaires. La flotte britannique comptait ainsi de nombreux marins et officiers allemands, suédois, norvégiens ou polonais, moins bien payés que leurs homologues britanniques. Le plus fameux d’entre eux, le Polonais Joseph Conrad, commanda des cargos vingt ans durant avant de connaître la célébrité en transposant ses souvenirs en une vaste œuvre littéraire, décrivant précisément la vie des marins et critiquant férocement le colonialisme.
Les capitaines faisant la route d’Extrême-Orient recrutaient dans ces conditions des « lascars », des marins issus d’Inde, de Chine, d’Indonésie ou du Moyen-Orient. Londres, Glasgow et d’autres grands ports comptaient donc dans leur population des marins venus du monde entier, d’abord en attente d’un embarquement de retour, puis finalement fixés là, regroupés par origine dans quelques rues ou quartiers. Les dirigeants de la NSFU oscillèrent entre deux attitudes à leur égard, sans que jamais l’unité du prolétariat mondial et de ses intérêts ne les effleure : syndiquer ces travailleurs originaires des colonies afin que les armateurs ne fassent plus pression à la baisse sur les salaires, ou leur interdire l’embauche pour réserver le travail aux Britanniques. La NSFU adopta plutôt la première attitude en période de plein-emploi et la seconde durant les épisodes de chômage. Un dirigeant de la NSFU, qui se révéla plus tard être un gangster, se targua d’avoir été l’initiateur d’un pogrom antichinois à Cardiff en 1911. Et Wilson lui-même, au printemps 1914, alla de port en port dénoncer ce qu’il appelait « le péril jaune » dans la marine marchande. La prétendue défense des intérêts des marins métropolitains par l’exclusion des lascars n’était pas l’apanage de la très ouvertement réformiste et patriote NSFU. La même question traversait en France, à la même époque, le syndicat CGT des marins, réputé syndicaliste révolutionnaire et internationaliste. Ainsi, en mars 1910, à Marseille des marins en grève pour le renvoi de leurs collègues arabes, moins payés, furent soutenus localement par la CGT des marins et désavoués par celle des dockers. Au congrès confédéral suivant, où la question de la légitimité de cette grève fut posée, le dirigeant du syndicat des marins donna raison à ses camarades de Marseille3. La guerre de 1914-1918 fut le sommet de la carrière d’Havelock Wilson, décoré du titre de commandeur de l’ordre de l’Empire britannique en 1917, et elle marqua l’intégration complète de la NSFU, et des autres bureaucraties syndicales, dans l’appareil d’État. Plus encore qu’en temps de paix, la Grande-Bretagne ne pouvait vivre sans un trafic maritime régulier et efficace. De 17 000 à 20 000 marins y laissèrent leur vie, dans des navires torpillés par les sous-marins allemands. Les navires coulés étaient payés aux armateurs et les marins survivants y gagnèrent le titre de « héros » indispensables à la nation. À la fin du conflit, la NSFU gérait l’embauche des équipages conjointement avec les armateurs, la cotisation syndicale était prélevée directement sur un salaire dont le montant était discuté entre Havelock Wilson et le patronat, bien loin des revendications et même des simples besoins vitaux des marins. En 1919, lorsque, avec le retour des soldats, le marché du travail se retrouva engorgé, la NSFU se chargea, avec la complicité des autorités, des employeurs et de la presse, de détourner le mécontentement des sans-emploi et le malaise populaire vers les marins d’origine coloniale ou chinoise, qui dans tous les ports de Grande-Bretagne furent alors la cible d’agressions verbales et physiques.
Les revendications des marins
La grève qui enflamma les équipages à partir d’août 1925 mit en avant bien des revendications au-delà du maintien du salaire, révélant les conditions de travail réelles des marins. Les équipages grévistes demandaient de faire 48 heures par semaine en mer et 44 heures au port, pas plus de 8 heures de suite pour les soutiers, pas de travail le dimanche au port, au lieu des 12 heures par jour, 7 jours sur 7, imposées par les armateurs. Oui, des hommes pelletaient du charbon dans une chaudière, à fond de cale, y compris par des températures extérieures de 40 degrés, 12 heures durant, 7 jours sur 7. Les marins voulaient des quartiers sains, de l’eau pour se laver, des traitements contre les puces, de l’espace pour dormir ; une nourriture correcte et la présence à bord de quelqu’un ayant des connaissances médicales ; des tenues de rechange de façon à ne pas être mouillés en permanence par mauvais temps ; la fin des retenues sur salaire pour la nourriture et la prétendue cotisation syndicale ; la fin du PC 5, c’est-à-dire de la carte de travail délivrée par la NSFU. Les grévistes voulaient le renvoi d’Havelock Wilson, surnommé Have-a-lot4, car il touchait 1 000 livres par an pour représenter des marins qui en gagnaient difficilement 10 par mois, lorsqu’ils avaient un embarquement. Ils voulaient enfin pouvoir élire des délégués et obtenir la promesse que les grévistes ne seraient pas réprimés.
Dès le premier débrayage, dans le port de Londres, la NSFU désavoua le mouvement et elle maintint cette position tout au long de la grève. Dès lors, non seulement celle-ci était illégale mais les grévistes ne touchaient aucun secours, financier, juridique ou organisationnel de leur syndicat. Les locaux, les liaisons et les caisses de la NSFU leur étaient fermés. À Londres, puis dans les ports touchés par la grève, les marins élurent donc des délégués de navires qui se réunissaient en comité de grève du port, avec les seuls militants qui soutenaient leur mouvement, ceux qui gravitaient autour de l’Internationale communiste. À Londres, par exemple, les marins portèrent Tom Mann, militant ouvrier expérimenté et l’un des fondateurs du Parti communiste de Grande-Bretagne, à la tête du comité central de grève.
Dans les ports de Grande-Bretagne même, le mouvement commença lentement et resta minoritaire. Le chômage massif et le poids de la NSFU permirent aux armateurs de recruter des jaunes par milliers, protégés par la police, et de remplacer des grévistes chassés à coups de gourdin. La lutte se focalisa autour du départ, ou non, des grands paquebots de la ligne transatlantique. Pour qu’un tel navire appareille, encore fallait-il que des charbonniers et des dockers acceptent de le charger et que les armateurs trouvent les centaines de marins, soutiers et employés de cabine nécessaires. Chaque appareillage, après une bataille d’influence sur les quais plus ou moins musclée, était fêté par la presse, le gouvernement et la NSFU comme l’annonce de la fin de la grève et une victoire contre le communisme. À l’arrivée à New York, les navires étaient isolés sur un quai gardé par la police qui interdisait tout contact entre les marins britanniques et les militants ouvriers américains.
Les familles des marins grévistes ou bloqués à l’autre bout du monde ne touchaient plus la part de salaire qui leur revenait. De plus, l’administration leur refusa le droit à l’allocation minimum des pauvres, très justement dite de subsistance, que les marins touchaient entre deux embarquements. Pire encore, on supprima également cette allocation aux marins au chômage et à leur famille puisque leur refus, réel ou supposé, d’embarquer montrait qu’ils soutenaient la grève.
Le mouvement gagne les antipodes
La grève tint deux mois dans ces conditions grâce au soutien des travailleurs des ports et à la nouvelle de son succès en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En effet, des dizaines de navires britanniques en escale dans ces anciennes colonies étaient bloqués en rade. Dans ces ports peuplés d’immigrants issus de la classe travailleuse britannique, les équipages grévistes bénéficiaient du soutien de la population et de certains syndicats.
Dans l’hémisphère sud, les commandants reçurent pour consigne ou décidèrent eux-mêmes de considérer les grévistes comme des mutins. Ils refusèrent donc de les nourrir et les forcèrent à débarquer. Mais ils ne trouvèrent pas d’équipage de rechange. Au contraire, la population et les militants hébergèrent les grévistes dans leurs locaux et dans leurs familles. Des collectes, des fêtes, des bals animés par les musiciens grévistes des orchestres des paquebots, des meetings permirent de faire connaître le mouvement, de soutenir le moral et de remplir les caisses de grève. Là encore, les militants de la mouvance communiste furent au premier rang et participèrent aux comités de grève des marins.
Le soutien des organisations syndicales et politiques, particulièrement en Afrique du Sud, n’allait pas sans arrière-pensées. Le mouvement des marins britanniques, comme tout ce qui contrariait l’influence de la métropole impériale, était, au moins formellement, soutenu par les partis nationalistes afrikaners, à commencer par ceux se réclamant des intérêts des travailleurs. Surtout, le Labour Party d’Afrique du Sud, au pouvoir en coalition avec le Parti national (afrikaner), sur la base d’une défense des intérêts des travailleurs blancs préfigurant l’apartheid, encourageait la ségrégation parmi les marins. Il tentait de s’annexer, sur cette base, la grève des marins britanniques. Malgré cette pression et celle, moindre mais du même ordre, exercée dans les ports australiens, les marins ne laissèrent pas dévoyer leur lutte et la ségrégation envers les marins des colonies n’apparut pas dans leurs revendications. Les lascars des équipages grévistes étaient d’ailleurs solidaires de la grève, ayant eux-mêmes des salaires encore plus misérables que leurs camarades britanniques5.
Cédant aux demandes de Londres, et suivant son propre sens de classe, le gouvernement australien traita les marins grévistes comme des mutins, et en condamnant 329 à des peines de prison et à de lourdes amendes. Les condamnés se rendaient en cortège aux séances du tribunal et jusqu’aux portes des prisons, accompagnés de leurs camarades grévistes et de travailleurs et militants australiens. Les emprisonnés disaient ironiquement que ce que l’Armée du salut australienne leur avait refusé, un toit, une paillasse et une gamelle de soupe, la justice le leur offrait aimablement…
Les autorités australiennes, à la demande expresse de Wilson, franchirent un pas de plus en interdisant aux syndicats locaux d’aider cette grève illégale. Les deux principaux dirigeants des comités de soutien furent même condamnés à quitter le territoire, sous prétexte qu’ils n’étaient pas nés en Australie et qu’ils troublaient l’ordre public.
La grève dans l’impasse
En octobre, faute de s’être étendue à l’ensemble des marins, voire à d’autres travailleurs, la grève était dans une impasse. Les bateaux repartaient, les uns après les autres, avec un nouvel équipage ou avec un équipage vaincu. En Afrique du Sud, les marins grévistes avaient désormais le choix entre rester à bord et être considérés comme des mutins ou aller à terre et être emprisonnés comme immigrants illégaux. Ils reprirent le travail le 10 octobre, toutefois aux conditions les moins mauvaises : la réembauche, le rapatriement pour ceux dont le bateau était déjà reparti, la promesse qu’il n’y aurait pas de sanction. Le travail reprit le 30 octobre en Australie, sans que les marins aient obtenu quoi que ce soit d’autre que la fierté d’avoir combattu. Quelques centaines de grévistes, sous l’autorité du comité de grève de Londres, continuèrent encore le combat derrière leur banderole « Héros en 1914, esclaves en 1925 », jusqu’à mi-novembre. La réduction de salaire s’appliqua donc et les conditions de travail restèrent ce qu’elles étaient.
Percy Laidler, un militant australien, participant enthousiaste au comité de soutien aux grévistes, écrit dans ses mémoires que la grève ne s’est jamais étendue aux lascars, c’est-à-dire au gros des troupes de la marine australienne6. Il en fut de même pour les équipages à forte composante indienne de la très nombreuse et très essentielle flotte britannique d’Extrême-Orient, particulièrement de l’Inde. Pour s’adresser aux marins des peuples colonisés et espérer les toucher, ne pas prêcher l’apartheid, sous une forme ou une autre, n’était qu’un début. Les grévistes britanniques avaient spontanément cette attitude. Mais il aurait fallu une politique volontaire, mettant en avant les intérêts et les perspectives communes des marins de toutes origines, en fait des prolétaires de tous les pays, tout en prenant en compte les rapports d’exploitation entre les métropoles et les colonies. Cette politique était dans le programme de l’Internationale communiste à ses débuts. Mais ce ne fut pas celle des militants et des partis qui sont intervenus lors de cette lutte, ni à Londres ni dans les autres ports de l’Empire.
La direction de l’Internationale communiste n’a pas aidé non plus les militants à évaluer la situation. La grève des marins, après l’avertissement du vendredi rouge et avant la grève générale de 1926, était un chapitre de la lutte de la classe ouvrière britannique pour ne pas faire les frais de la décadence de sa bourgeoisie. Cette situation, analysée par Trotsky dans la brochure déjà citée, parue avant la grève, ne pouvait, selon lui, se résoudre que par la lutte des travailleurs pour le pouvoir. Encore fallait-il les y préparer et les y conduire.
Or, en cet été 1925, l’Internationale communiste, sous l’autorité de Zinoviev alors allié de Staline, c’est-à-dire de la bureaucratie montante, prônait l’alliance et la bonne entente avec les directions syndicales britanniques, afin de lutter contre les dangers de guerre. « Staline s’imaginait que les leaders des trade-unions étaient disposés à assurer un appui à la république des soviets contre l’impérialisme britannique et qu’ils en étaient capables », écrivait Trotsky dans son autobiographie, publiée en 1929. Alors même que le TUC, lors de son congrès annuel en septembre, refusait de donner la parole aux délégués des marins en grève et ne faisait pas un geste pour soutenir le mouvement, ses émissaires étaient reçus en grande pompe en Union soviétique. Pour ne pas gêner cet accord entre bureaucrates, les militants communistes qui, pourtant, dirigeaient la grève dans de nombreux ports et sur trois continents, étaient laissés sans politique. Ainsi, l’hebdomadaire de l’Internationale communiste en langue anglaise, Inprecor, publia le 24 septembre 1925, sous la plume du dirigeant communiste Harry Pollitt, un compte rendu du congrès du TUC et une analyse de la situation du mouvement ouvrier britannique… sans un mot sur la grève7. Il fallut attendre le 29 octobre pour qu’Inprecor publie enfin un article titré « La grève non officielle des marins anglais », signalant qu’elle était terminée…
Les historiens Baruch Hirson et Lorraine Vivian, auteurs de l’unique brochure d’ensemble sur ce mouvement8, ont constaté que cette grève avait disparu de l’histoire. Il est bien sûr naturel que les historiens conservateurs ou simplement conformistes l’aient ignorée. Quant aux syndicats britanniques, ils racontent leur propre histoire en omettant ce peu glorieux épisode, de même que les universitaires sociaux-démocrates qui leur sont liés. Les staliniens, du temps où il existait des historiens de cette école particulière, l’ignoraient tout autant, ne retenant de l’époque que les « succès » de leur politique de rapprochement avec le TUC.
Cette grève a pourtant eu lieu et elle a démontré la possibilité d’une action spontanée de travailleurs qui, quoique séparés par des milliers de kilomètres, savent se dresser ensemble contre le patronat, l’État et la bureaucratie syndicale. Aujourd’hui, plus encore qu’il y a un siècle, pour le monde entier et plus seulement pour l’Empire britannique, la marine marchande est un élément essentiel de l’économie. Cela permet aux armateurs de rançonner la terre entière. Cela peut demain offrir une arme puissante aux travailleurs, par l’intermédiaire des millions de marins, fils et filles de tous les pays réunis dans la même exploitation.
18 août 2025
1Les dominions étaient les colonies comme le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, où la majorité de la population était « blanche », en conséquence des massacres, des épidémies du temps de la conquête et du peuplement par des Européens, et qui, au fil des décennies, avaient acquis une certaine autonomie politique par rapport à Londres. Unifiée depuis 1910, l’Afrique du Sud était aussi considérée comme un dominion, bien que les Blancs y aient été en minorité.
2En mai 1926, les propriétaires des mines repartirent à l’attaque contre les salaires. En soutien aux mineurs, le Trade Union Congress (TUC), organisation fédérant l’ensemble des syndicats britanniques, appela à la grève générale, la seule dans l’histoire de la Grande-Bretagne. Mais le TUC appela à la reprise du travail au bout de neuf jours, laissant les mineurs lutter seuls contre leurs patrons pendant des mois, jusqu’à une défaite totale.
3Ronan Viaud, Le syndicalisme maritime français, Presses universitaires de Rennes, 2005.
4Celui-qui-a-le-paquet.
5Jonathan Hyslop, « A British Strike in an African Port », The Journal of Imperial and Commonwealth History, 2015.
6« The Life and Time of Percy Laidler » sur Solidarityforeverbook.com
8Baruch Hirson et Lorraine Vivian, Strike Across the Empire. The Seamen’s Strike of 1925 in Britain, South Africa and Australasia, Clio Publications, Londres, 1992.