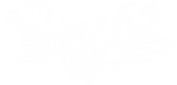Nous publions le troisième et dernier article sur l’histoire de la Chine. Nos lecteurs pourront retrouver les deux premiers volets dans les numéros 246 (mars 2025) et 247 (avril 2025).
La Chine actuelle, qui depuis plus de trente ans, surprend par sa croissance économique explosive et continue, semble n’avoir plus rien de commun avec celle des années 1949-1976 quand Mao était au pouvoir. Pourtant nombre de ses racines puisent toujours dans l’ère maoïste. En 1949, quand les armées de Mao s’emparèrent du pouvoir, elle était un pays dévasté, au bord de l’effondrement. Les splendeurs passées de la Chine avaient attisé les convoitises de tous : puissances étrangères, seigneurs de guerre, armées de Tchiang Kai-chek et brigands, et tous n’avaient attendu qu’un signal pour se jeter dessus.
Les canonnières britanniques avaient détruit, un siècle auparavant, les canaux d’irrigation, les barrages sur les grands fleuves et toutes les infrastructures vitales pour l’agriculture. De nombreuses terres avaient été abandonnées, les paysans fuyant vers les villes pour n’y trouver que les bagnes industriels.
Il restait bien peu d’industries, à part en Mandchourie où elles dataient de l’occupation japonaise, et peu de voies de chemin de fer, à part celles que les armées, japonaise et du Kuomintang1, avaient plus ou moins entretenues pour le transport des troupes. Deux décennies de guerres avaient apporté bombardements et massacres… En faisant bombarder les digues du fleuve Jaune, pour provoquer une inondation qui arrête l’avance japonaise, Tchiang Kai-chek2 avait noyé une région entière.
Le PC et la révolte paysanne
La situation était tellement insoutenable pour la population que la retraite des armées japonaises, en 1945, opéra comme un déclencheur. Dans chaque village, les paysans pauvres réglèrent leurs comptes avec les usuriers, spéculateurs, grands propriétaires, seigneurs, que l’armée d’occupation japonaise ne protégeait plus. Ils osèrent, comme ils en rêvaient depuis des décennies, leur faire rendre gorge. Leur haine et leur rage n’avaient plus de limite.
De son côté, la direction du PC tentait de sceller une alliance avec le Kuomintang en se faisant reconnaître comme de bons nationalistes capables de gouverner avec lui. C’était sous-estimer la corruption de cette armée, considérée comme incapable même par ses soutiens, les bourgeois, souvent aussi grands propriétaires et usuriers. L’inquiétude des dirigeants du PC grandissait car ils se trouvaient sous la pression de millions de paysans déchaînés. L’alliance avec le Kuomintang devenait contre nature et bien des cadres du PC faillirent y passer. Se couper des paysans était pour eux la défaite assurée.
À l’été 1946, le PC changea donc d’orientation et décida de prendre la tête de cette révolte. Les groupes de partisans, guérilleros chevronnés mais isolés, se transformèrent en une véritable armée. Ces ex-paysans sans terre, fugitifs, déclassés… devenaient des instructeurs et trouvaient dans cette tâche une mission à accomplir : chasser les Japonais et les pilleurs du Kuomintang. Cette politique a « redonné une âme et une foi à la troupe, formé des cadres d’une mentalité et d’un niveau primaire, mais énergiques, complètement désintéressés et fanatiques de leur cause »3. L’armée du PC devint l’armée nationaliste par excellence, celle qui chasse l’envahisseur et tous ceux qui se sont commis avec lui.
Une équipe dirigeante marquée par son époque
Les dirigeants du PC avaient survécu aux persécutions du Kuomintang, à la suspicion des paysans et à leurs conflits internes ; ils avaient un passé en commun, reçu plus ou moins la même formation, partageaient une même façon de voir le monde et étaient convaincus que leur devoir était de consacrer leur vie à la transformation d’une Chine à la dérive. Opiniâtres et endurants, ils portaient la marque de toute une époque.
Ces dirigeants avaient été formés dans leur jeunesse dans une période où la société tout entière était confrontée à des bouleversements remettant tout en cause. Le développement de la bourgeoisie d’Europe et des États-Unis faisait exploser les vieux cadres du passé. L’assurance et l’agressivité de cette nouvelle classe sociale, forte de son succès, remettaient inexorablement en question l’équilibre mondial. Après bien des rapines et des coups de force, les contradictions de son système avaient explosé au 20e siècle en deux guerres mondiales, comme l’humanité n’en avait encore jamais connu sous cette forme, et conduit à une révolution dirigée par une classe ouvrière jeune et qui s’y émancipait. Le vieux monde craquait aux coutures au point que le maillon le plus faible de cette Europe en guerre, la Russie, tout juste capitaliste mais à la société encore moyenâgeuse, voyait son régime tsariste renversé par une révolution menée par une avant-garde, la classe ouvrière consciente, dirigée par le parti communiste bolchevique.
Les jeunes Chinois partis étudier en France furent projetés, de leurs provinces où régnaient à la fois l’immobilisme ancestral et le chaos, dans le chaudron politique brûlant qu’était l’Europe de cette époque. Sans toujours percevoir toute la complexité de la situation dans laquelle ils se trouvaient, ils furent trempés dans ce monde, s’en imprégnèrent, et à l’école du mouvement ouvrier européen des années 1920, devinrent des militants comme seule cette période pouvait en former.
Ils retinrent des idées fortes du mouvement ouvrier : renverser les pouvoirs en place, féodaux et impérialistes étrangers et s’appuyer sur les masses dans ce but. Mais beaucoup oublièrent les autres principes du communisme, à savoir que le système capitaliste est fondé sur la propriété privée, y compris celle des forces productives (industries lourdes, transports, ouvrages d’art, etc.) utiles à la société et que le communisme, lui, est fondé à l’opposé, sur leur propriété collective. Ces deux systèmes ne peuvent coexister, et l’internationalisme, principe fondamental des idées communistes, est un postulat de base.
Mais en URSS, la lutte faisait rage au sein de la direction du jeune pouvoir soviétique et le camp stalinien qui allait l’emporter se mit à défendre l’idée que le socialisme était possible dans un seul pays. Cela allait convenir parfaitement à tous les petits-bourgeois des pays pauvres, qui rêvaient de devenir de grands bourgeois en exploitant leurs propres paysans, pauvres et analphabètes. Cette vision politique qui revient à accepter la domination de l’impérialisme convenait parfaitement aux dirigeants chinois, eux dont l’essentiel de la formation s’était fait contre les forces réactionnaires qui maintenaient les Chinois dans un univers moyenâgeux.
Il n’était plus utile d’être internationalistes, sauf en paroles, et ils pouvaient devenir des nationalistes conséquents, oubliant ainsi que seule la classe ouvrière, celle qui travaille dans les entreprises, les bureaux et les banques, en particulier dans les bastions de la bourgeoisie en Europe et en Amérique, peut non seulement la renverser mais la remplacer et que cela suppose une révolution à l’échelle mondiale.
Zhou Enlai, un des dirigeants communistes les plus influents, accompagna Mao presque toute sa vie. Né dans une famille de lettrés, il milita dans le Mouvement du 4 mai4, ce qui lui valut la prison. En France, il fonda la branche européenne du PC en 1922. Puis, à 26 ans, il devint un responsable de l’académie militaire de Whampoa.5
Lin Biao, issu de la petite bourgeoisie rurale, devint communiste à 18 ans, milita dans le mouvement étudiant puis entra à l’académie militaire en 1925. Après la Longue Marche6, il devint un commandant renommé après avoir repris la Mandchourie à l’armée japonaise. Les mêmes et d’autres partirent aussi se former en URSS, comme Liu Shaoqui, qui à son retour, organisa les cheminots de Shanghai durant la montée révolutionnaire de 1925-1927. À peine nés politiquement, ils se retrouvèrent à la tête de la révolution de 1927. Encore plus soudainement, ils tombèrent sous les coups de la répression et, désorganisés, ils fuirent des villes. Ils cherchèrent en tâtonnant une voie pour continuer. En petits groupes armés, ils se cachèrent dans les campagnes et glissèrent vers les actions de guérilla. S’ouvrit alors une longue période de fuite en avant à chercher empiriquement des solutions pour se faire accepter des paysans, s’approvisionner, et s’établir là où ils le pouvaient.
L’entrée dans les villes et la période démocratique : établir et stabiliser le pouvoir
Quand les troupes du PC entrèrent dans les villes en 1949, craignant d’effrayer la bourgeoisie en soutenant la classe ouvrière, Mao fit tout pour que rien ne change et avertit : « Ne lancez pas à la légère les mots d’ordre pour l’augmentation des salaires et la réduction des heures de travail. » « Ne vous hâtez pas d’organiser la population urbaine dans la lutte pour des réformes démocratiques et pour l’amélioration des conditions de vie. »7 Quand des usines se mirent en grève, comme à Shanghai, le même Mao déclara que : « Toute grève perlée et tout sabotage seront punis. »8 Les fonctionnaires du Kuomintang, ses officiers passés à l’armée rouge et les patrons restèrent en place et dans les réunions, les communistes se retrouvèrent à côté de leurs bourreaux de 1927. Si le PC était implanté dans les régions reculées du nord, il ne l’était pas dans le sud, plus riche et plus développé, ni le long des côtes, où se situaient les grandes villes, Canton et Shangai. C’était peu à l’échelle de la Chine et l’équilibre du pouvoir était précaire.
La guerre de Corée (1950-1953)
Le pouvoir du PC était d’autant plus précaire que dès 1950, les États-Unis se lancèrent dans la guerre de Corée pour rappeler à l’ordre les pays d’Asie voulant s’échapper de leur zone d’influence au profit de l’URSS. Le PC chinois décida de s’impliquer dans la guerre, malgré son infériorité technique, profitant d’un élan de patriotisme dans la population ou le suscitant. Il multiplia les campagnes : Soutenir les Lions de l’avant et Résister à l’Amérique et des caricatures de l’Oncle Sam étaient promenées dans les villages.
L’armée chinoise restait largement sous-équipée face à l’armée américaine. Pourtant, elle la repoussa en quelques mois. Le conflit se solda par un retour aux frontières précédentes, coupant en deux la Corée. Ce n’était pas une victoire, mais c’était une revanche après un siècle de déshonneur, un exploit contre une armée impérialiste.
Fort du soutien de la population, le PC put éliminer les membres restants du Kuomintang et même épurer l’administration et le parti. Ce fut la « campagne des Trois Anti », visant les détournements de fonds, le gaspillage et le bureaucratisme. Le succès relatif en Corée attira des millions de jeunes parmi la petite bourgeoisie surtout urbaine. Il renforça l’appareil à l’échelle du pays et sa colonne vertébrale : l’armée. Et une fois le pouvoir stabilisé, la direction s’attaqua à l’économie.
Rattraper le retard économique
La Russie soviétique avait mis des années à tenter de surmonter son retard, son industrie balbutiante étant bien incapable d’apporter à la paysannerie ce dont elle avait besoin. En Chine, sans accumulation préalable de richesses , ce que Marx a appelé l’accumulation primitive et sans l’aide des pays avancés qui, hostiles, pratiquaient le blocus économique, la principale force capable de produire des richesses était la paysannerie. Mais elle était si nombreuse et si peu productive qu’il était impossible d’en dégager un surplus de richesse permettant de servir de base à une industrie. Devant ce dilemme, véritable obsession pour les dirigeants du parti, leurs seuls moyens réels étaient leurs cadres et l’armée elle-même, face à une masse de plusieurs centaines de millions de paysans affamés. La mise au pas de la population allait se faire de façon incessante, en commençant par les cadres du parti, par le biais d’épurations et de purges régulières pour les discipliner et les faire plier afin qu’ils encadrent les grandes campagnes lancées par la direction.
En apparence, ces campagnes mettaient tout le monde en mouvement mais beaucoup les évitaient. Il revenait aux cadres de transmettre le feu sacré, sans parler de ceux qui profitaient de cette agitation pour servir leurs intérêts ou pour abuser du pouvoir. Mais ces campagnes permettaient de faire marcher la population d’un même pas, même s’il était trop lent.
Le PC disposait de tous les leviers d’un État ; il imposa des salaires bas, les paysans furent obligés de vendre leur production à l’État… Tous les surplus produits par la paysannerie furent drainés vers l’industrie sans que jamais la population en bénéficie.
Le 1er plan quinquennal, de 1953 à 1957, fut une première grande campagne, menée avec l’aide de l’URSS qui le finança en partie et sur le modèle de ce qu’avait fait ce grand voisin qui semblait avoir réussi. Les dirigeants chinois marchèrent vers l’industrialisation tambour battant, prévoyant 146 projets de grande envergure, surtout dans l’industrie lourde. Pour les financer, les terres agricoles devaient être modernisées, mais leur productivité ne réussit pas à décoller. Les nouvelles usines manquaient d’ingénieurs et de techniciens qualifiés que ceux venus de Russie ne compensaient pas. Nombre de projets furent abandonnés. Cette campagne « à la russe » apparut comme un demi-échec au point que le PC en annonça rapidement une nouvelle, mais « à la chinoise » cette fois, et qui proposait au pays de « marcher sur ses deux jambes », l’agriculture et l’industrie.
Du Grand Bond en avant (1958-1961) à la Révolution culturelle
Au nom de cette deuxième campagne du Grand bond en avant, la centralisation fut allégée. Chaque région devait être plus autonome. Les cadres devaient augmenter, coûte que coûte, les rendements industriels et agricoles. Les paysans regroupés en Communes populaires de 20 000 à 40 000 personnes, furent organisés en brigades militarisées, envoyées aux champs, dans les usines et à des grands travaux. Mais le développement d’une industrie locale se révéla vite un fiasco, comme les hauts-fourneaux dans les villages, où les paysans devaient faire fondre jusqu’à leurs couverts pour n’obtenir finalement que de la fonte de mauvaise qualité. Dans ce chaos, les paysans devaient, de plus, céder une large partie de leur récolte à l’État ; ce fut bientôt la catastrophe et la famine. Mais le pouvoir continua d’exporter des céréales pour pouvoir investir ensuite dans l’industrie.
D’une certaine façon, ce coup de force contre la population rapporta, malgré tout, quelques résultats : assainissement des marais, défrichements, construction de digues et la part de richesses transférées de l’agriculture vers l’industrie passa de moins de 10 % à plus de 20 %. Ce fut au prix d’un nombre incalculable de victimes dont près de 30 millions dues à la famine. Cet épisode allait rester un véritable traumatisme pour l’ensemble de la société chinoise.
C’est consciente du mécontentement qui agitait en partie la population urbaine, dont les cadres du parti et les travailleurs, que la direction du PC s’engagea dans une nouvelle campagne, cette fois en faisant appel à la jeunesse petite-bourgeoise. En 1966, puis pendant environ deux ans, des millions d’étudiants et de collégiens, les Gardes rouges, furent fanatisés et lancés contre des cadres et des intellectuels, accusés d’être des contre-révolutionnaires. Il fallait sans doute que les dirigeants du PC ressentent un danger bien réel. Après la famine durant le Grand bond en avant, considérée comme un échec de Mao lui-même, il fallait faire accepter à la population de continuer à vivre comme dans un camp retranché, dans l’austérité la plus totale.
Les Gardes rouges furent chauffés à blanc, entre autres par la manifestation, à Pékin, d’environ un million de jeunes, amenés en train de toute la Chine, à l’été 1966. Ils eurent carte blanche, seules les casernes et les usines leur étant interdites. Détruisant tout ce qui était culturel, ils s’attaquaient aux intellectuels et aux cadres, saccageaient leurs maisons, les battaient. Les organismes du parti et les administrations elles-mêmes furent ravagés, les cadres soumis aux « séances de lutte », autrement dit d’humiliations et de tortures.
Derrière cette folie destructrice et barbare, le pouvoir était bien là : l’armée, une fois de plus aux commandes, les encadrait, la police fournissait les adresses, les trains étaient gratuits… Les travailleurs, instinctivement, étaient hostiles aux Gardes rouges, surtout quand ils s’entendaient dire : « Maintenant que nous nous sommes emparés du pouvoir, nous ne pouvons plus tolérer la fainéantise. »9 Aussi, pour prendre les devants, Mao lança un appel aux travailleurs de Shanghai pour qu’ils interviennent. Mal lui en prit car si, officiellement, ils reprirent les slogans de la Révolution culturelle, ils y mirent leur propre contenu : la haine des cadres du parti et du syndicat de leur usine, et se mirent en grève pour des augmentations de salaire.
À l’hiver 1966, Shanghai fut alors paralysée par une grève de deux mois. D’autres grèves suivirent dans toutes les régions industrielles. Des affrontements sanglants eurent lieu entre les Gardes rouges et les ouvriers, parfois soutenus par la population. Alors, le pouvoir fit intervenir l’armée : couvre-feu, blindés dans les rues, artillerie lourde et même bombes au napalm. Devenus inutiles, vingt millions de Gardes rouges furent envoyés de force à la campagne, tandis que les administrations qui avaient été démantelées et les cadres qui avaient été purgés mais encore vivants furent remis en place. Cette campagne avait visé en premier le parti comme jamais il ne l’avait été. Toute opposition était éliminée, la population citadine et en particulier les travailleurs étaient muselés.
La mort du « Grand Timonier » (1976)
En 1972, les États-Unis, enlisés dans la guerre du Vietnam, changèrent d’orientation en Asie et renouèrent avec la Chine, une décision qui allait changer en profondeur la situation. D’autant plus que la période était marquée par la succession de Mao. Plus sa fin approchait, plus la lutte entre les candidats à sa succession devenait féroce. Deng Xiaoping gagna la course10. Un mois seulement après la mort de Mao, fort de son poids dans le parti et l’armée, il fit arrêter ceux qui étaient à la tête de la faction maoïste. Appelés la Bande des quatre, ils furent accusés des excès de la Révolution culturelle, et la veuve de Mao fut condamnée à mort. Ce procès sonna comme la fin officielle du maoïsme, permettant à Deng Xiaoping de s’installer au pouvoir.
* * *
Le développement spectaculaire de l’économie chinoise, depuis la mort de Mao, il y a près de cinquante ans, conforte les dirigeants un peu radicaux de nations qui tentent de se libérer de la pression économique et politique de l’impérialisme. La Chine est pour eux un exemple, celle qui a réussi en s’appuyant sur sa paysannerie pauvre et sa classe ouvrière, au fur et à mesure que celle-ci se développait. C’est en exploitant ces masses de façon inexorable, que le PC au pouvoir a réussi à développer une industrie performante qui permet à la Chine d’être considérée aujourd’hui comme l’atelier du monde. Dans sa compétition dans le monde impérialiste, la Chine assume la production de base des produits industriels les plus communs. Et si son industrie n’en est pas encore à concurrencer tout à fait les industries de pointe, chères au monde impérialiste, elle n’a de cesse d’y parvenir.
Un certain nombre d’autres dirigeants de pays pauvres ont essayé sa recette, Vietnam, Corée du Nord… mais bien plus nombreux encore sont ceux qui l’ont abandonnée, à Cuba ou en Afrique. Ces pays dont la révolution était moins profonde et qui ont abandonné la voie de la transformation sociale et économique, en acceptant les diktats de l’impérialisme, avaient bien moins de raisons que la direction chinoise. Car celle-ci avait la particularité d’avoir plongé ses racines dans le chaudron de la révolution bolchevique. C’est elle, cette direction jacobine, radicale, maquillée en communiste, forte d’un soulèvement paysan dont elle a pris la tête, qui s’est maintenue malgré les conflits internes, peut-être à cause de sa formation commune. Mais elle a également profité d’un grand pays avec une population très nombreuse, de richesses naturelles importantes, de l’absence d’ennemis aux frontières, et surtout d’une très longue pratique de l’étatisme qui s’est prolongée de l’Empire à la dictature de Mao. C’est tout cela qui s’est conjugué pour donner la Chine d’aujourd’hui. On peut laisser les admirateurs de la Chine voir là une sorte de miracle, voire de modèle à opposer à la situation de l’écrasante majorité des autres pays. Pour notre part, nous ne voyons aucun miracle à la surexploitation d’une population, grâce à un appareil d’État tentaculaire et à des mesures à peu de frais (santé, nourriture bon marché et autres…). En revanche, ce que nous voyons dans la Chine, c’est qu’elle abrite la majorité du prolétariat mondial sous une forme très concentrée. Et c’est dans cette réalité que se trouve un avenir pour sa population, pour l’humanité, bien plus que dans la course effrénée et sans fin pour égaler les grandes puissances, une course qui ne ferait qu’ajouter un concurrent dans la mêlée à laquelle se livrent les puissances impérialistes aujourd’hui.
22 octobre 2025
Annexe : voici ce que nous écrivions dans la Lutte de Classe no 76, publiée le 8 octobre 1963 :
“Il y a quatorze ans, la Chine
…] La vieille Chine était morte, et bien morte. Mais le Parti communiste chinois n’était pas un parti révolutionnaire prolétarien. […] Le problème qu’il se posa, une fois au pouvoir, ne fut pas celui de l’extension de la révolution, mais celui de faire échapper l’économie nationale de la Chine à l’exploitation de l’impérialisme mondial afin de permettre à la bourgeoisie de survivre. Ce n’était ni la tradition de Marx, ni celle de Lénine, c’était en fait la continuation du rêve de Sun Yat-sen.
Mais les conditions de vie des masses avaient considérablement changé. Elles avaient gagné la terre, le nouveau gouvernement avait supprimé la corruption et le gaspillage éhonté qui régnait sous Chang.
En octobre 1949, un quart de l’humanité échappait à l’emprise de l’impérialisme. Pourtant le nouveau régime ne consacrait pas la libération définitive de ces 600 millions d’hommes. Sous le signe de la “démocratie nouvelle”, il les attelait à une tâche de construction économique dont allaient surtout profiter les couches dirigeantes, la bourgeoisie nationale. Mais quoi qu’il en soit, cette date marque tout de même la plus grande défaite de l’impérialisme depuis Octobre 1917, et dans les usines et les chantiers de la Chine nouvelle, croît et mûrit un nouveau prolétariat. »
1Parti nationaliste, fondé par Sun Yat-sen, en 1912, après la révolution de 1911 qui a mis fin à l’empire et instauré la république. Il dirigea la Chine jusqu’à la victoire militaire du PC en 1949.
2Général, chef du Kuomintang, il écrase la révolution ouvrière à Shanghai, en 1927 puis, soutenu par les États-Unis, il dirige la Chine jusqu’à la victoire de Mao, en 1949.
3Jacques Guillermaz, Histoire du parti communiste chinois, tome 2 : de Yenan à la conquête du pouvoir, Payot, p. 338.
4Manifestation à Pékin, en 1919 contre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale qui, par le traité de Versailles, attribuèrent au Japon un territoire chinois, auparavant colonie allemande, plutôt que de le rendre à la Chine, pourtant leur alliée.
5Créée en 1924, près de Canton, grâce à l’URSS et sur le modèle de celle fondée par Trotsky, dirigée par Tchiang Kai-chek et Zhou Enlai, elle fut une pépinière de cadres militaires nationalistes et communistes.
6Retraite de l’armée de Mao en 1934-1935, devant les troupes du Kuomintang, du sud au nord du pays, sur 12 000 km. Elle fit environ 100 000 victimes. C’est durant cette période que Mao réussit à asseoir son pouvoir sur le parti.
7Mao Zedong, « Télégramme au commandant du front de Louoyang après la reprise de la ville », 8 avril 1948, Œuvres choisies, tome 4, ELE, p. 260.
8Mao Zedong et Zhu De, « Proclamation de l’APL (Armée Populaire de Libération) de Chine », 25 avril 1949, Œuvres choisies, tome 4, ELE, p. 415-416.
9Ken Ling, The revenge of Heaven. Journal of a young Chinese, traduit par Miriam London et Ta-Ling Lee, New York, Ballatine Books, 1972, p. 165-171. Traduction française : La vengeance du ciel, Robert Laffont, 1981.
10D’origine paysanne, recruté par Zhou Enlai, en 1923, à Paris, où il milita, puis il séjourna en URSS. Il participa à la Longue Marche et fut un dirigeant militaire. Après 1949, il devint secrétaire général du PC. Critique du Grand Bond, il fut violemment attaqué pendant la Révolution culturelle et exclu. Mais il parvint à se faire réintégrer, à regravir les échelons et même finir vice-Premier ministre en 1973.